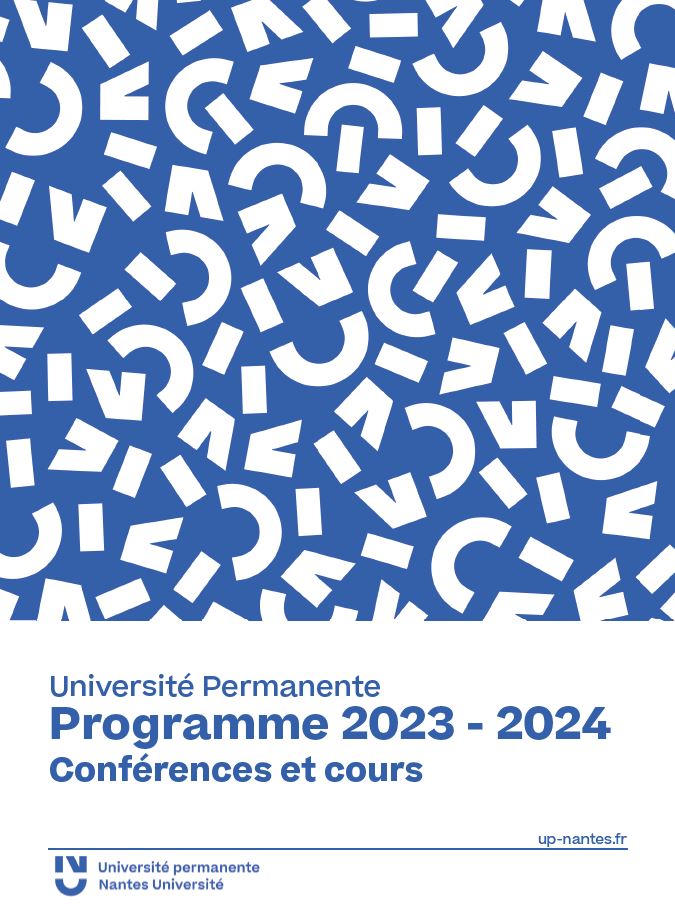- Dates des cours : 9oct-6nov-20nov-4déc-18déc-15janv-29janv-26févr-12mars-26mars-23avr-7mai
- Heure de début du cours : 10:00
- Heure de fin du cours : 12:00
- Jour du cours : Mercredi
- Intervenant : Yves FRAVALO
Yves FRAVALO
L’intitulé retenu pour ce cours, tourné d’abord vers la lecture de Philippe Forest, n’implique aucune idée de filiation, d’imitation ou même d’influence. Il renvoie, platement, à un ordre de succession en matière de programmation universitaire, un ordre lui-même fondé sur une expérience de lecteur : saisie, soudain à l’automne 2022 – au cœur même du « Cycle proustien » -, d’échos entre le récit de rêve qui apparaît à la clôture, ou presque, de Pi Ying Xi, Théâtre d’ombres, et l’évocation du rêve de la grand-mère dans la chambre de Balbec où le héros vient de faire l’expérience contradictoire de « la survivance et du néant » (pleine reviviscence de la figure perdue et sentiment, rendu plus aigu, de la perte). Et dans le prolongement de cette saisie – qui aurait joué comme une fonction d’éveil – affirmation toujours plus insistante du sentiment d’autres rencontres entre le grand chef d’œuvre clos depuis un siècle désormais et une œuvre de notre temps toujours en cours d’accomplissement.
Rôle fondateur, chez l’un et l’autre écrivain, de l’expérience du deuil ; interrogation sur le statut du réel et du moi, en prise sur la question du sommeil et du rêve; méditation sur les liens de la mémoire et de l’oubli… C’est au sein d’espaces réflexifs de cette sorte – excédant ce qu’implique proprement la notion de « thème » – que notre lecture, répondant aux sollicitations du texte de Philippe Forest, pourra remonter vers celui de son grand prédécesseur. Il sera possible alors de se livrer au jeu très proustien de l’analogie sur fond de différence, dans une approche toujours très prudente et attentive à ce qui fait la spécificité de chacune des œuvres.
Proximité, sans doute, entre les deux écrivains, quant à la visée de l’écriture, si l’on songe à la déclaration de Philippe Forest disant qu’il s’agit pour lui « d’essayer de donner une forme à [son] expérience, qui la maintienne en permanence vivante en lui donnant un sens ». Mais peut-on oublier la précision qui suit immédiatement : « tout en lui conservant sa dimension de non-sens absolu » ? La littérature, on le voit, demeure, pour l’auteur de L’Enfant éternel, le lieu où « la vie [est] éclaircie », mais elle n’est plus le lieu d’accès à « la vraie vie ». Pas de salut par l’art, désormais ; de nos jours, l’écrivain n’avance plus comme guidé par une « promesse d’aurore » semblable à celle que le héros proustien entend dans le « rougeoyant septuor » ; l’encre de l’écriture ne peut plus que travailler à la persistance – et pour combien de temps ? – de certaines ombres au seuil de la nuit qui menace de les absorber.
Notre lecture de Philippe Forest portera sur les trois romans suivant – dont la réédition en Folio semble de ne pas devoir être programmée pour la prochaine rentrée :
- Le Siècle des nuages, coll. « Blanche » 2010, NRF, Gallimard ;
- Je reste roi de mes chagrins, coll. « Blanche », 2019 ;
- Le Chat de Schrödinger, coll. « Blanche », 2013.