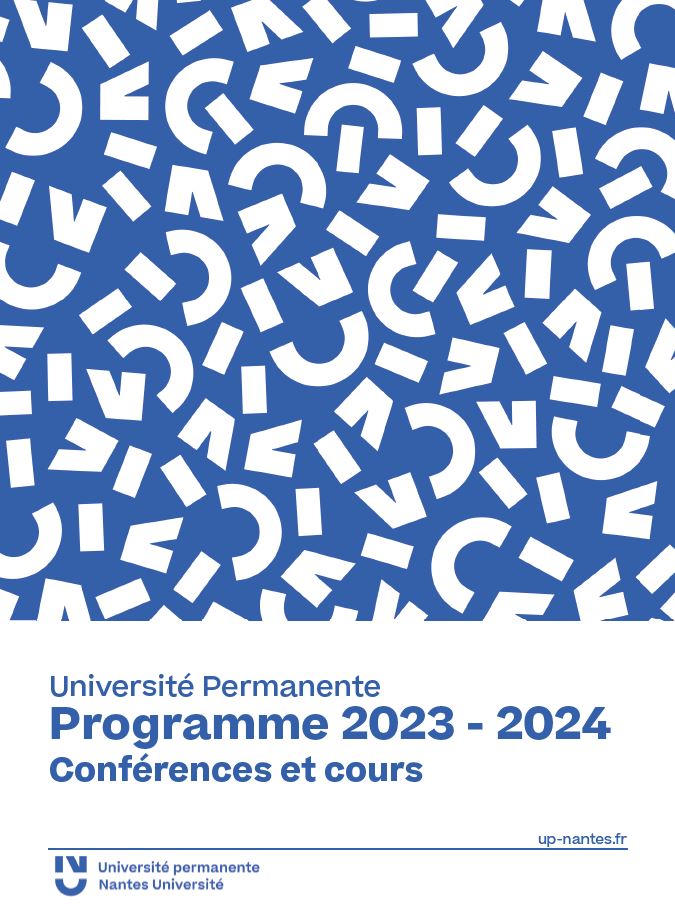- Dates des cours : 6nov-13nov-20nov-27nov-4déc-11déc
- Heure de début du cours : 10:00
- Heure de fin du cours : 11:30
- Jour du cours : Lundi
- Intervenant : Christophe PATILLON
Christophe PATILLON
Faire connaître la richesse de l’histoire sociale de la Loire-Atlantique et de l’Ouest en partant de luttes et d’événements marquants. A noter : les cycles sont indépendants les uns des autres et aucune connaissance en histoire sociale n’est requise !
- 1833, les typographes nantais et la défense du métier. En mai 1833, soixante-quinze ouvriers imprimeurs soutiennent par la plume le projet porté par quelques-uns d’entre eux de faire reconnaître par les autorités une association philanthropique… mais qui ne cache pas pour autant sa nature revendicative. Elle fut pour certains le premier syndicat créé en France. Disons, plus humblement, qu’elle a ouvert avec d’autres les chemins de l’émancipation collective des travailleurs.
- La fin des « anarchos » : Nantes et la grève des dockers (1907). Du fait de l’irrégularité du trafic portuaire, le travail des dockers est marqué par la précarité à Nantes, comme dans tous les ports du monde. Les dockers constituent un véritable prolétariat en haillons… qui veut cesser de l’être. Le conflit de 1907 lui en offre l’occasion.
- La décennie noire du syndicalisme (1922-1935). La CGT sort déchirée de la Première Guerre mondiale, et les conflits internes ont raison d’elle. La minorité révolutionnaire fonde la CGT-Unitaire en 1921 persuadée que la révolution est à l’ordre du jour. Commence alors une période sombre pour le mouvement ouvrier…
- « Ils ont tué Rigollet ! » : 1955, une révolte ouvrière en Basse-Loire. Le conflit de 1955 occupe une place à part dans l’histoire sociale de la Loire-Atlantique par sa durée et sa dureté. Six mois durant, à Saint-Nazaire puis à Nantes, il a remis la classe ouvrière au coeur de l’actualité politique et sociale.
- 1969, Guichard au Dresny : un ministre dans la boue. Nous sommes le 16 novembre 1969. Au Dresny, on s’affaire pour recevoir un ministre, en l’occurrence Olivier Guichard, baron du gaullisme. Le député-ministre a prévenu que son passage serait rapide : trente minutes pas plus, car il est attendu à Nantes. Il ne se doutait pas qu’un groupe de jeunes paysans avait un autre programme en tête.
- Le baroud d’honneur : les dockers et la grève de 1991-1992. Le 20 août 1947, les parlementaires votent, sans discussion et dans l’urgence, la réforme de l’organisation du travail dans la manutention portuaire que lui soumet le gouvernement Ramadier. Le 6 septembre 1947, la loi est promulguée. Elle dote enfin le docker d’un statut sécurisant son intermittence, l’arrachant en somme à la précarité. Son maintien est au coeur du conflit social des 1991.
N’hésitez pas à visiter la bibliothèque du Centre d’histoire du travail (RDC du bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes). L’emprunt d’ouvrages y est possible gratuitement.