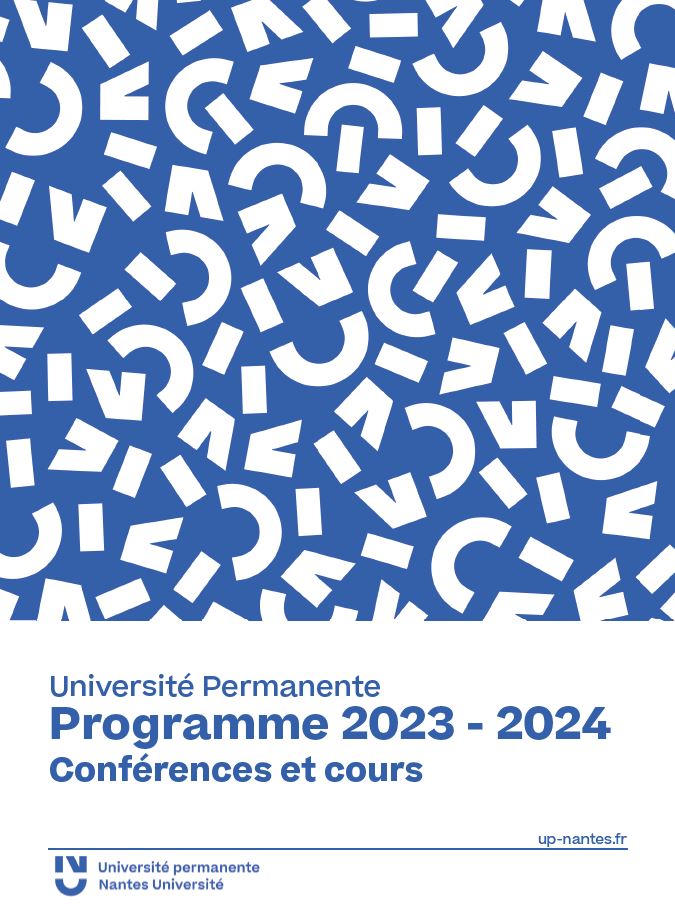- Dates des cours : 15janv-22janv-29janv-5févr-12févr-19févr
- Heure de début du cours : 10:00
- Heure de fin du cours : 11:30
- Jour du cours : Lundi
- Intervenant : Christophe PATILLON
Christophe PATILLON
Faire connaître la richesse de l’histoire sociale de la Loire-Atlantique et de l’Ouest en partant de luttes et d’événements marquants. A noter : les cycles sont indépendants les uns des autres et aucune connaissance en histoire sociale n’est requise !
- Les vignerons et les « rouges » (1891-1914). Dans un courrier de décembre 1891, le socialiste Brunellière écrit à son ami Augustin Hamon : « Les syndicats de vignerons ont été organisés par des délégués de l’Union syndicale de Nantes et par moi. (…) Le Progrès, journal opportuniste, prétend que c’est l’organisation d’une nouvelle jacquerie. C’est ce qui arrivera si les propriétaires veulent voler leurs colons et leurs fermiers. » Les vignerons, menacés par leurs propriétaires et le phylloxéra, sont en colère et le font entendre sur ces terres réactionnaires.
- Les coopératives et la loi du marché (1920-1940). Le 23 avril 1934, la Banque des coopératives de France, forte de douze agences régionales dont l’une fixée à Nantes, dépose son bilan. Comment expliquer une telle faillite ? Certains y voient une funeste conséquence de la crise économique de 1929 mais d’autres pointent la politique irresponsable de dirigeants coopératifs…
- Les grèves de 1953 en Loire-Atlantique. « Les travailleurs ne viennent pas dans vos réunions, c’est vrai ; encore faut-il que vous en recherchiez les raisons, mais n’oubliez pas que, malgré cela, les travailleurs ruminent. » Le militant qui tient ces propos en février 1953 n’est pas un inconnu. Il se nomme Benoît Frachon. Il ne sait pas que l’été venu, une grève massive va toucher la fonction publique, mais pas seulement. En Loire-Atlantique, les métallos sont aussi de la partie. Retour sur une page méconnue de l’histoire sociale nationale.
- Mai 1968, Nantes s’embrase. « La Commune de Nantes », tel est le titre du livre que Yannick Guin consacre au mouvement de mai-juin 1968 à Nantes. La référence au mouvement parisien de 1871 est osée, certes, mais elle rappelle que le « Mai nantais » fut exceptionnel, fruit d’une histoire sociale dont les caractéristiques essentielles ne se retrouvèrent nulle part ailleurs.
- Les paysans contre l’agrobusiness : histoire de veaux et d’hormones. Souvenez-vous : c’était le temps où les escalopes de veau achetées au supermarché rapetissaient comme par magie le temps d’une cuisson. En septembre 1980, ce veau qui fond dans la poêle est l’objet de toutes les attentions. On le savait sans intérêt gustatif, on le soupçonne dorénavant d’être dangereux pour la santé…
- Chantelle 1981 : la colère des petites mains. Chantelle est une société textile créée en 1876 par un ingénieur parisien, Auguste Gamichon, qui a mis au point une machine permettant de fabriquer un tricot élastique, produit alors très innovant. Un siècle plus tard, il établit une usine à Saint-Herblain. Et c’est ici que des ouvrières sont se révolter contre les cadences qu’on leur impose et un management vexatoire.
N’hésitez pas à visiter la bibliothèque du Centre d’histoire du travail (RDC du bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes). L’emprunt d’ouvrages y est possible gratuitement.